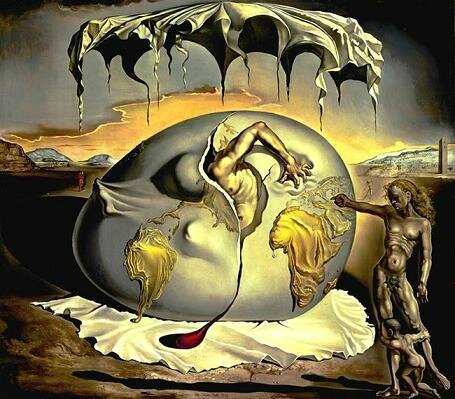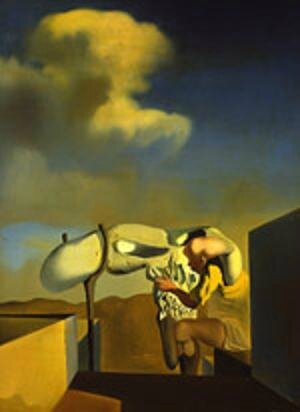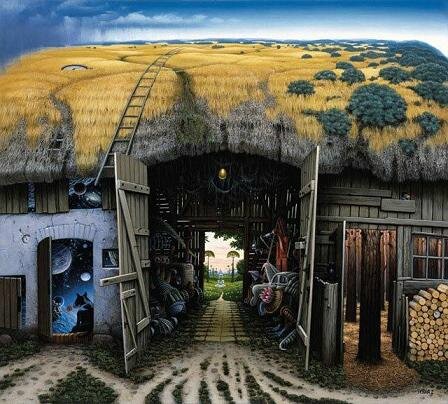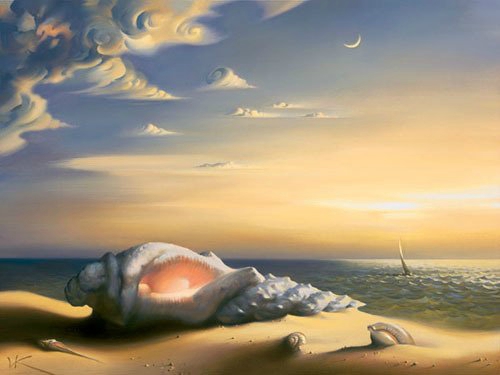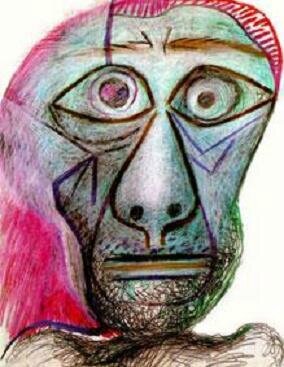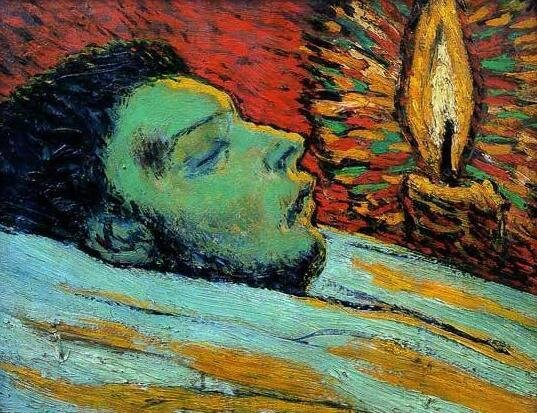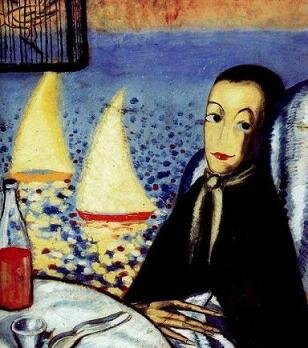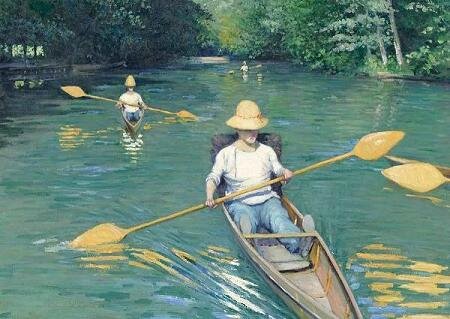« Chaque vie vaut la peine d’être vécue. Chaque personne doit être respectée, quel que soit son état de santé ou de dépendance. Toute souffrance doit être soulagée. » (Dino Cinieri, le 5 octobre 2015 au Palais-Bourbon).

Pendant les deux journées sur trois séances publiques à l’Assemblée Nationale, les députés ont débattu sur la proposition de loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie en deuxième lecture. J’en avais fait le compte-rendu à l’issue d’une lecture qui n’a pas servi à grand chose sinon à changer deux ou trois détails.
Parce que je considère que ce sujet est essentiel pour la société, et que chaque mot compte, chaque virgule peut donner des interprétations différentes, je propose ici de retranscrire quelques extraits intéressants du débat parlementaire. Ils ne constituent pas un échantillon représentatif des échanges (pour cela, je vous incite à aller consulter le script des séances), mais ils m’ont paru marquants dans ce débat. J’avais fait ce même genre d’exercice pour la première lecture en commission et on peut constater que ce sont à peu près les mêmes députés qui ont participé au débat.
Un texte considéré comme une étape vers l’euthanasie ?
Toute l’argumentation du gouvernement pour faire adopter le plus largement ce texte sur la fin de vie tend au double langage et à l’ambiguïté : vis-à-vis des opposants à l’euthanasie, il a expliqué que la proposition de loi n’allait pas trop loin puisqu’il ne donnait aucune autorisation à tuer. Mais c’est surtout les partisans de la légalisation de l’euthanasie, issus de sa propre majorité, que le gouvernement cherche à séduire en affirmant que ce texte ne serait qu’une étape, qu’un pas supplémentaire vers cette euthanasie (ce qui nourrit le doute sur la sincérité du gouvernement).
Ainsi, la Ministre des Affaires sociales Marisol Touraine a été relativement floue à ce sujet : « Je l’ai déjà dit ici même, le débat, comme tout débat de cette ampleur, reste ouvert. Vous aurez aujourd’hui, en tant que parlementaires, comme auront à le faire vos successeurs, à juger de l’application de cette loi. Et si plus tard une étape supplémentaire vous apparaît nécessaire, vous aurez alors à en décider. » (5 octobre 2015). Histoire de dire aux ultras : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.

Un peu plus tard dans la soirée, elle a récidivé, toujours pour rassurer ses ultras : « Il ne faudrait pas oublier les avancées fondamentales qu’il comporte dans la reconnaissance de la parole et de la volonté du patient en fin de vie. Il me semble que certains d’entre vous en sous-estiment la portée, alors qu’il s’agit d’une véritable rupture par rapport à l’état du droit aujourd’hui. C’est à partir de là que d’autres évolutions seront envisageables un jour. » (5 octobre 2015). C’est bien sûr la dernière phrase qui est essentielle dans les intentions du gouvernement. En gros, il voudrait légaliser l’euthanasie mais n’ose pas, tout en disant qu’il l’envisage. Même discours hypocrite que sur le droit de vote des étrangers.
Dans la discussion concernant l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, Marisol Touraine a confirmé encore cette volonté d’évolution dans une remarque à Roger-Gérard Schwartzenberg, ardent partisan de l’euthanasie qui s’opposait à l’arrêt des ces soins vitaux : « Monsieur Schwartzenberg, n’ouvrez pas un débat qui pourrait affaiblir votre position. Le fait que l’alimentation et l’hydratation ne seraient pas des traitements ne plaide pas en faveur du suicide assisté ou de l’euthanasie. La suppression de l’alinéa ne viendrait pas à l’appui de la thèse que vous défendez, et que j’écoute avec beaucoup d’attention et d’intérêt. » (5 octobre 2015). Là encore, c’est la dernière proposition de phrase qui est la plus éloquente, attention et intérêt.
Un passage que n’a pas laissé passer le député Xavier Breton pour épingler la ministre : « Je reviens sur l’argumentation que madame la ministre vient d’opposer à M. Schwartzenberg, et selon laquelle, dès lors qu’on est favorable au suicide assisté, on considère nécessairement que l’hydratation et la nutrition artificielles constituent des traitements. Une telle logique nous renforce dans la conviction qu’il faut se garder de certaines dérives. Peut-être la ministre devrait-elle revenir à ce point. ».
La députée Michèle Delaunay, ancienne ministre et porte-parole du groupe socialiste (le plus nombreux) pour ce texte, a su désamorcer cette hypocrisie de la ministre : « Vous le savez, certains auraient aimé que nous allions plus loin, d’autres jugent que nous allons trop loin. Sur ce sujet si profondément humain et intime, il était nécessaire de rechercher le plus large consensus. Nous l’avons fait à l’issue de la première lecture dans cette assemblée et, pour ma part, j’invite chacun de nous à confirmer ce vote. » (5 octobre 2015). Comprendre : sans modifier le texte adopté en première lecture.
La députée Isabelle Le Callennec a réaffirmé le même souci du consensus pour son groupe Les Républicains : « Dans sa majorité, le groupe Les Républicains partage pleinement l’esprit de leur proposition de loi : le refus de l’acharnement thérapeutique et de l’obstination déraisonnable, la non-souffrance de la personne, mais aussi l’interdiction de tuer, qui doit rester absolue, autrement dit, soulager mais pas tuer. Nous estimons en effet que le droit à la vie est le premier des droits de l’Homme et que personne ne peut disposer de la vie d’autrui. C’est la raison pour laquelle nous restons opposés à toute légalisation de l’euthanasie. (...) Nous estimons, au contraire, que notre corpus juridique doit créer les conditions favorables à un accompagnement tout au bout de la vie. Certains de nos semblables se trouvent dans une situation d’extrême fragilité et rien dans notre regard ne doit trahir l’idée qu’ils ne seraient plus dignes de vivre. Nous disposons de nombreux témoignages d’équipes qui travaillent dans des unités de soins palliatifs. Si les demandes de recours à l’euthanasie existent, dans l’immense majorité des cas, elles ne sont pas réitérées, dès lors que les personnes sont soutenues et accompagnées, et que leur souffrance est soulagée. » (5 octobre 2015).
Le lendemain, Xavier Breton a insisté de nouveau sur le dessein du gouvernement : « Ce texte fait très clairement le choix de l’éthique de l’autonomie, comme le montrent, du reste, les mots prononcés hier par la Ministre de la Santé dans son propos liminaire : "Ce texte permettra de franchir une étape considérable. L’opposabilité des directives anticipées, couplée à la reconnaissance de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, renverse, et c’est bien là l’essentiel, la logique de décision : c’est le patient, et non plus le médecin, qui devient le maître de son destin". Où est la vulnérabilité ? Nous sommes en plein dans l’éthique de l’autonomie : CQFD ! Ce n’est pas nous qui le disons : c’est la ministre elle-même qui l’affiche, sans doute pour rassurer les membres de sa majorité. Je le répète : nous considérons que ce texte répond à la seule logique de l’autonomie et de la liberté et qu’il ne prend pas assez en compte celle de la vulnérabilité. » (6 octobre 2015).
C’était aussi cette impression assez pessimiste qui est ressortie de l’intervention du député Nicolas Dhuicq : « Je ne crois pas que nous nous arrêterons là : nous irons de plus en plus loin, avec bonne conscience, vers une société de plus en plus déshumanisée. Elle fera de moins en moins confiance aux professionnels pour prendre les décisions, elle sera de plus en plus paranoïaque et compliquée. » (6 octobre 2015).
Le risque d’eugénisme n’est pas écarté
L’un des deux rapporteurs du texte portant sur les malades en fin de vie, le député Alain Claeys, a confirmé (en utilisant d’ailleurs un adjectif peu digne de la personne humaine) que sa proposition s’appliquerait dans la situation des personnes comme Vincent Lambert, ce qui paraît aberrant (bien qu’admis par le Conseil d’État) puisque Vincent n’est ni malade, ni en fin de vie mais avec un handicap lourd : « Les malades en état "végétatif" pourront également bénéficier de ce traitement à visée sédative. Il faudra, pour cela, que leur volonté en ce sens soit recueillie. Elle pourra l’être au travers de la personne de confiance qu’ils auront antérieurement désignée ou des directives anticipées qui s’imposeront désormais au médecin. » (5 octobre 2015).
C’est l’une des grandes inquiétudes sur ce texte, exprimée par Dino Cinieri : « J’ai avec moi la liste des soixante-sept associations de personnes en situation de handicap (...). Ces associations nous ont écrit il y a quelques jours pour nous faire part de leurs craintes, madame la ministre. Elles estiment que ce texte peut être dangereux pour les personnes en situation de handicap complexe de grande dépendance. Ainsi, pour nombre de personnes dans ce cas, l’alimentation et l’hydratation artificielles sont courantes et constituent un soin qui améliore leur qualité de vie tout au long de leur existence. Ce mode d’alimentation est un soin de prévention et de compensation des troubles de la déglutition inhérents à la déficience motrice des personnes en situation de handicap complexe. » (5 octobre 2015).
Traitements ou soins ?
L’une des pierres d’achoppement du texte concerne l’alimentation et l’hydratation artificielles et leur caractérisation en soins ou en traitements. Si la question semble un débat sémantique très intellectuel sinon médical, la réponse revêt une importance extrême : en fin de vie, on arrête les traitements mais on doit maintenir les soins jusqu’au bout pour garder la personne dans le meilleur confort. Or, dans son interprétation de la loi du 22 avril 2005 rendue publique le 24 juin 2014, le Conseil d’État a considéré que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont des traitements. Le texte proposé veut donc clarifier juridiquement les choses en instituant définitivement dans la loi cette interprétation administrative, mais par ce fait, comme l’a expliqué plus haut le député Dino Cinieri, il pourrait mettre en danger toutes les personnes en dépendance incapables de déglutition.

Gérard Sebaoun a proposé un éclairage un peu différent sur ce sujet : « Je pressens bien que le débat portera sur la qualification ou non de traitement de l’hydratation et de l’alimentation. Je voudrais m’appuyer (...) sur l’avis rendu en 2007 par deux sociétés savantes, la Société française de gériatrie et gérontologie et la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Selon elles, la très grande majorité des patients en fin de vie n’éprouveraient pas la sensation de soif car la déshydratation entraîne la sécrétion d’opioïdes cérébraux à l’action antalgique. Certains auteurs pensent même que la déshydratation peut améliorer le confort en diminuant les vomissements, les encombrements, les bronchites, les ascites, les œdèmes, réduisant ainsi la douleur. Ils considèrent également que l’hydratation parentérale n’améliore pas la sensation de soif des patients en fin de vie, au contraire. Par ailleurs, l’alimentation parentérale par sonde de gastrostomie, puisque c’est ainsi que cela finit le plus souvent, exposerait à de multiples complications, en particulier la pneumopathie d’inhalation. Enfin, l’alimentation et l’hydratation n’influeraient guère sur la vie de patients arrivés en phase terminale. » (5 octobre 2015).
Xavier Breton, opposé à attribuer à ces soins le "statut" de "traitements", a prôné très fermement une précision du texte : « Il serait important que, dès cette deuxième lecture au niveau de notre Assemblée, nous sachions s’il y a une injonction, obligation d’arrêter les traitements en cas d’obstination déraisonnable ou s’il s’agit simplement d’une faculté offerte, à charge ensuite à la collégialité de prendre la décision. (...) Obligation ou faculté ? C’est tout de même un sujet important et il faudrait savoir où nous en sommes (...). Ce n’est pas la même chose d’imposer la fin des traitements en cas d’obstination déraisonnable que d’en offrir la faculté. Dans le premier cas, les professionnels de santé, en particulier les médecins, sont complètement déresponsabilisés. Dans le deuxième, nous en resterions à l’état du droit, avec l’engagement d’une procédure collégiale. Pourquoi passer à l’obligation ? » (5 octobre 2015).
La réponse de Jean Leonetti a été de rester dans la cohérence logique entre la fin de l’obstination déraisonnable et la décision d’arrêter les traitements : « Deux éléments doivent être pris en compte. Tout d’abord, il faut proscrire l’obstination déraisonnable, ce qui ne signifie pas que l’on puisse se passer de l’avis du médecin. Ce sont justement les médecins, en formation collégiale, qui apprécient le caractère déraisonnable ou non de l’obstination. Dès lors que les médecins jugent l’obstination déraisonnable, il faut être logique et mettre fin aux traitements. Pour autant, le Conseil d’État introduit une restriction : la volonté de la personne. Même en cas d’obstination déraisonnable, les traitements ne peuvent pas être interrompus si la personne concernée s’y oppose. (...) La seule obligation du médecin est d’être cohérent avec sa propre appréciation. Il ne saurait poursuivre des actes dont il considérerait qu’ils sont inutiles, disproportionnés ou déraisonnables. L’ambiguïté qui pouvait exister est compensée par le fait que la définition de l’obstination déraisonnable relève d’une définition collégiale au cas par cas et par la prise en compte de l’avis de la personne concernée, exprimé de manière directe ou de manière indirecte par le biais des directives anticipées et de la personne de confiance. » (5 octobre 2015).
Juriste et constitutionnaliste distingué, Roger-Gérard Schwartzenberg s’est permis de rappeler, pour la forme, la primauté du législateur sur une instance administrative, aussi prestigieuse soit-elle : « Seul un arrêt plutôt ambigu du Conseil d’État semble considérer l’hydratation comme un traitement. (...) Quel que soit le respect que l’on peut avoir pour le Conseil d’État, rien n’interdit au législateur, qui représente la souveraineté nationale et est en conséquence placé au-dessus de ce dernier dans la hiérarchie des producteurs de normes juridiques, de prendre une autre orientation, à charge pour les juridictions de s’aligner sur sa décision. » (5 octobre 2015).
Le député Gilles Lurton a embrayé sur une précision juridique qui ne donnerait pas raison à Jean Leonetti : « Si, en phase terminale, leur arrêt est parfois nécessaire et souhaitable pour éviter toute obstination déraisonnable et irrespectueuse, il me paraît injuste de définir l’alimentation et l’hydratation artificielles exclusivement comme des traitements. Ce sont aussi des soins que l’on doit aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable. Comme l’ont indiqué le Comité consultatif national d’éthique ainsi que le Conseil d’État dans son arrêt du 24 juin 2014, le seul fait de devoir irréversiblement et sans espoir d’amélioration dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre ne caractérise pas à soi seul, je souligne ces termes, un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable. » (5 octobre 2015).
Et les sondages ?
Face aux entreprises de désinformation que font les groupes de pression pour la légalisation de l’euthanasie, le second rapporteur du texte, le député Jean Leonetti a voulu rappeler : « Puisque j’entends souvent que l’immense majorité des Français serait favorable à l’euthanasie, permettez-moi de rappeler le sondage réalisé par l’Institut français d’opinion publique, l’Ifop, à la suite des propositions qui ont été formulées : 96% des Français se sont déclarés favorables, en cas de souffrance réfractaire et lorsque la mort est proche, à une sédation profonde et continue jusqu’au décès. » (5 octobre 2015). Donc, un score beaucoup plus grand que ceux favorables à la légalisation de l’euthanasie.
La carence des soins palliatifs
Isabelle Le Callennec a évoqué l’importance des soins palliatifs : « Notre rôle de législateur est de parvenir à concilier le droit des patients à s’exprimer et le devoir des médecins à soulager. (...) Ce dimanche 11 octobre sera la journée mondiale des soins palliatifs. Ce pourrait être l’occasion d’adresser un message d’espoir aux équipes qui font un travail remarquable et aux bénévoles des associations qui s’engagent avec humanité dans l’accompagnement psychologique. L’attente est grande s’agissant du développement des soins palliatifs, tout comme l’est la crainte de toute tentative de légalisation de l’euthanasie qui serait forcément un prétexte pour relâcher les efforts. » (5 octobre 2015). Il faut marteler qu’annoncé par François Hollande le 17 juillet 2012, le grand plan développement des soins palliatifs n’a toujours pas été lancé, plus de trois ans plus tard !
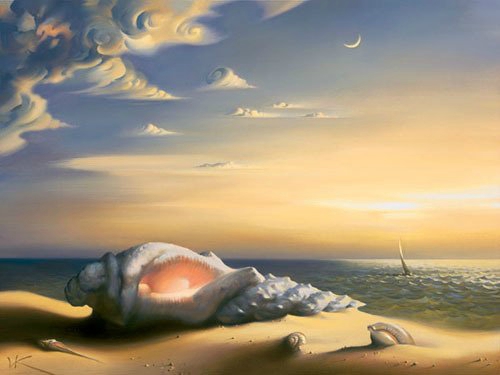
Même l’une des plus grandes zélatrices de l’euthanasie l’a admis : la demande d’euthanasie serait beaucoup plus restreinte si chaque patient avait accès aux soins palliatifs qui est pourtant un droit depuis plus de treize ans (loi du 4 mars 2002). En effet, la députée écologiste Véronique Massonneau a bien voulu le reconnaître : « Reconnaissons-le : de trop nombreuses demandes de patients de mettre fin à leurs jours sont la conséquence du manque de places en soins palliatifs, de notre échec à leur apporter un accompagnement adapté pour que leurs derniers jours soient apaisés et dignes. » (5 octobre 2015).
Ce que recouvre le texte proposé
La définition par le rapporteur Jean Leonetti a été clairement explicitée, ainsi que ses attentes : « Le texte dont nous débattons est un texte d’équilibre entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, mais également entre la solidarité que l’on doit manifester envers les plus fragiles, et l’autonomie que l’on doit respecter y compris et surtout à leur égard. Robert Badinter disait que la politique pouvait être considérée comme un affrontement dans une arène de gladiateurs. Ce peut être aussi la recherche consensuelle du bien commun, qui dépasse tout clivage, pour faire en sorte qu’il corresponde à l’attente de nos concitoyens. » (5 octobre 2015).
Jean-Frédéric Poisson, le successeur de Christine Boutin, a insisté sur le réglage du curseur entre deux considérations : « Madame Jacqueline Fraysse [PCF] me permettra de reprendre à mon compte la présentation qu’elle a faite du débat. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’encadrer une pratique médicale supervisée par deux principes : la liberté individuelle et le respect de la vie. Je suis parfaitement d’accord avec cette manière de présenter la question. Tout le problème est de savoir à quel niveau respectif on situe la liberté individuelle et le respect de la vie. » (5 octobre 2015).
Pour Jean-Louis Touraine, ce texte ne présente aucune "avancée" : « La sédation profonde et continue, mesure phare de ce texte, est déjà autorisée. Cette possibilité, en effet, est offerte aux patients depuis le décret de François Fillon du 29 juillet 2010 préconisant la mise en œuvre de traitements à visée sédative en cas d’arrêt des traitements curatifs. » (5 octobre 2015).
La dignité humaine
Dino Cinieri a cité la situation concrète d’une mère de famille en pleine détresse : « Chaque vie vaut la peine d’être vécue. Chaque personne doit être respectée, quel que soit son état de santé ou de dépendance. Toute souffrance doit être soulagée. J’ai une pensée pour une jeune femme courageuse, Anne-Dauphine Julliand, dont la petite fille était condamnée à court terme, et qui rappelle dans un livre poignant, "Deux petits pas sur le sable mouillé", une citation du médecin et académicien Jean Bernard : "Quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, ajoutons de la vie aux jours". Cette phrase illustre bien ce que sont les services de soins palliatifs. Celui qui meurt a besoin d’affection, de douceur, de compréhension, de soulagement. » (5 octobre 2015).

Le député a poursuivi : « Selon le philosophe Paul Ricœur, si cher à notre Ministre de l’Économie, la "dignité" renvoie à l’idée que "quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain" ; elle est donc liée à la personne elle-même, non à un état de vie. (...) Toute personne mérite un respect inconditionnel, quel que soit son âge, son sexe, sa santé physique ou mentale, sa religion ou sa condition sociale. Limiter la dignité à la situation de fin de vie est par conséquent une erreur : les actes de soin et de soulagement doivent être administrés à tout moment de la vie, dans le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes. » (5 octobre 2015).
Jean Leonetti, lui aussi, a considéré la dignité comme intrinsèquement liée à la personne tout en introduisant le mot "indigne" différemment : « Dire que le mot "dignité" n’est pas défini en droit, c’est oublier ceci : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits". Il suffit donc de se rapporter à l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’Homme pour savoir ce qu’est la dignité. (...) Rappelons effectivement que la dignité est consubstantielle de l’humanité et que les conditions de la fin de la vie peuvent être indignes. Le terme est bien utilisé dans ce sens : on a droit à des conditions dignes et à l’apaisement de ses souffrances. » (5 octobre 2015).
La définition de la phase terminale
Toujours très précis et argumenté dans ses interventions, Jean Leonetti a précisé ce que signifie le "pronostic vital engagé à court terme" : « Certains médecins cancérologues considèrent que la phase terminale commence à partir du moment où se produit un échappement thérapeutique, c’est-à-dire où ils ne peuvent plus garantir que la situation va s’améliorer. Cette situation, on le sait, peut heureusement durer des mois ou des années. Les médecins nous ont rappelé que l’expression "phase terminale" couvrait un espace de temps beaucoup trop large pour notre objectif, cette situation d’impasse thérapeutique où l’on ne parvient pas à calmer le patient alors que, dans le même temps, le pronostic vital est engagé à court terme. C’est la raison pour laquelle nous avons utilisé ce terme qui correspond (...) à des jours et des heures, non à des mois et des années. (...) L’expression "pronostic vital engagé à court terme" semble donc plus restrictive et plus précise. Tel est du moins le sentiment des médecins de soins palliatifs, cancérologues ou gérontologues. » (5 octobre 2015).
Le lendemain, Jean Leonetti est revenu une nouvelle fois sur ce sujet du pronostic vital : « D’une certaine façon, nous sommes tous en fin de vie, puisque nous sommes susceptibles de mourir dès l’instant où nous naissons. Il est vrai que nul ne connaît le jour et l’heure, mais la médecine dispose d’éléments objectifs pour formuler un pronostic à moyen terme. De surcroît, plus le terme approche, plus le pronostic est facile à déterminer. Il est bien difficile d’affirmer qu’un malade atteint d’une pathologie donnée a encore une année à vivre ; en revanche, il est très facile, lorsque son état s’est vraiment dégradé, de dire qu’il ne vivra pas plus de trois ou quatre jours. La médecine technique d’aujourd’hui peut prolonger des vies comme jamais elle n’a été capable de le faire (...). Tout ce qui est techniquement possible est-il humainement souhaitable ? La réponse est non. Nous sommes donc confrontés à un conflit de valeurs entre une éthique de l’autonomie et de la liberté, d’une part, et une éthique de la vulnérabilité et de la solidarité, de l’autre. » (6 octobre 2015).
Dans le second et dernier volet de ces extraits, j’aborderai la disposition principale de ce texte, à savoir la sédation profonde et continue ainsi que son application sur des personnes très vulnérables n’ayant pas la possibilité d’exprimer leurs propres souhaits.
Aussi sur le blog.
Sylvain Rakotoarison (20 octobre 2015)
http://www.rakotoarison.eu
Pour aller plus loin :
Verbatim de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.
Indépendance professionnelle et morale.
Fausse solution.
La loi du 22 avril 2005.
Adoption en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.
La fin de vie en seconde lecture.
Acharnement judiciaire.
Directives anticipées et personne de confiance.
Chaque vie humaine compte.
Sursis surprise.

http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20151006-loi-claeys-leonetti-2015AW.html
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/loi-claeys-leonetti-verbatim-de-la-173093
http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2015/10/20/32793119.html